Bisaigüe – épisode 1
Depuis combien de temps était-on enfermées ? Je ne sais plus. Peut-être une année puisque ça avait commencé en mars 2020. Je dormais Lexomil. Je dormais dans la chambre que j’aurais voulu quitter avant tout ça. Je dormais dans la chambre blanche. Je luttais pour compter encore les jours. Il fallait compter les jours parce qu’il fallait des arrêts de travail, parce que les enfants allaient revenir, parce que les gens ne donnaient plus souvent de nouvelles et il fallait savoir à partir de quand s’inquiéter. Il fallait et pourtant tout aurait aussi bien pu partir à la dérive. Demain n’avait aucun sens. Tout le temps je me disais que plus rien ne tenait sans ce demain. Les mesures de confinement avaient démarré très tardivement. Trop tard. Et puis on s’était enfoncé dans des mesures sans cesse renouvelées. Expressément d’abord. Tacitement ensuite. Certain·es avaient oublié pourquoi on était enfermé·es.
Une nuit, je me suis réveillée en sueur. La chambre ruisselait de vapeur autour de moi. Il fallait sortir vite de cette pièce. Ouvrir la porte. Respirer. Au moment d’appuyer sur la poignée, j’ai peur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose vibre derrière la porte. C’est un bruit que je ne connais pas. Pas ici. J’appuie sur le métal froid. Le salon n’est plus là : à la place je vois juste un corridor poisseux. Il fait trop humide, la chaleur est pesante, il fait noir et il y a une odeur de cave et de fioul. Je ne sais pas quoi faire et je reste là. La chambre est derrière moi, connue, sûre, blanche et confortable. Mais je n’envisage pas de refermer la porte. J’avance. Faudrait pas, mais j’avance.
Je le connais cet endroit. Le ronflement de la chaudière, l’odeur écoeurante, l’angle du début d’escalier que je vois au fond, sans une lueur faible. Je connais. L’escalier est commun, quelques marches et virage à 90 degrés. Je le sais en montant : le long du mur le plus long, à ma droite, un long tigre est peint, jaune et brun, un peu passé, un peu plus déteint encore que dans mes souvenirs. Je suis déjà venue.
Je monte l’escalier en passant la main sur le mur, comme pour vérifier que le tigre est bien peint. Les renflements légers des bords de la figure animale sont là, la peinture est écaillée et part parfois en éclats sous mes doigts. Je m’arrête quelques marches avant le haut, soudain inquiète. Est-ce que c’est une bonne idée de se jeter là-haut ? Est-ce que je me souviens bien ? Suis-je bien dans cette maison que je croyais engloutie avec mes souvenirs ? Je n’étais pas venue depuis plus de vingt ans. Est-ce qu’il y a des gens là-haut. Certains que je croisais ici sont morts ? D’autres ne peuvent être là. Mais alors qui ? Et si c’était désert. Est-ce que ce serait mieux ?
Nous sommes en 2021, peut-être 2022. Le grand confinement a commencé il y a longtemps déjà. Je voulais sortir, partir loin, dès que ça serait possible. Et je me retrouve là où tout a commencé. La Bisaigüe, telle qu’en 1995, un peu décatie, pour ce que je vois des fondations, peut-être dynamitée, mais debout. J’ai peur.
Je pousse la porte. La maison est toujours là. Je parcours les pièces doucement en guettant les bruits, les miens et ceux des habitants s’il y en a. La grande salle à manger qui donne sur le jardin. Le salon japonisant avec les petites tables et les tatamis. La cuisine aux carreaux blancs et noirs. La salle de réunion comme un bateau avec ses hublots. Et surtout, la salle de bain, peinte en bleu pâle, avec ses moulages de membres, bras, jambes, pieds et mains qui sortent des murs. C’est comme avant. Déserté, tout grince et suinte l’humidité et le froid, des odeurs âcres imprègnent tout. Habité, au moins encore récemment. Squatté plutôt : des baskets violettes un peu défoncées mais récentes ont failli me faire trébucher dans le couloir, un cendrier trône sur le rebord de la baignoire, avec des parcelles blanches comme la neige, cendre fraîche, clope fumée aujourd’hui ou hier.
Au bout du couloir, la porte de cette salle qui était pleine de matériel vidéo et photo. Plus rien à part les étagères métalliques et quelques boîtes en carton, un fauteuil éventré. Et la fenêtre sur le jardin. La piscine est pleine d’eau de pluie et de feuilles. Un pull rouge git à côté dans l’herbe. J’avais 14 ans et j’avais un pull rouge comme celui-ci.
La porte claque derrière moi. Je suis dehors. Dans la maison un bruit, de l’autre côté. Et déboule derrière moi une femme un peu plus âgée que moi. À peine, un peu plus grande et plus mince. Elle porte des gants et une sorte de voile blanc enveloppe ses cheveux et ses épaules et masque un peu sa bouche. Sa tenue blanche, bouffante, mal ajustée, est trouée par endroits, rapiécée.
« Céline », me dit-elle. « Je soigne des malades dans les squats pas loin. On a cousu des tenues protectrices. Sans le masque et la visière c’est étrange, je dois avoir l’air d’une apicultrice en déroute. »
Elle n’a pas l’air surprise de me voir.
« Amélia », je réponds. « Je ne sais pas très bien où je suis tombée ».
Sans me répondre, elle me montre ma chambre. Au 1er étage. Dans le long couloir, elle énumère : « Là c’est ma chambre, ici celle de Marie-Laure, là celle de Saskia. Saskia vient moins souvent depuis quelque temps. »
« Dans l’autre aile du bâtiment, c’est Catherine, son mari et quelques stagiaires qui sont là. Ils étaient en stage quand le confinement a commencé. Ils sont restés. On se parle ce soir ? »
« Oui »
Je ne sais pas. Je ne comprends pas très bien où je suis. Je reste un peu sur mon lit. Cette ancienne demeure bourgeoise et excentrique, devenue un temps un centre socio-éducatif, tombé à l’abandon, est squattée par des gens qui m’accueillent sans sourciller. Depuis un an, tout est tellement étrange et vide. Cette irruption absurde ne me gêne pas, au contraire, comme si la folle inquiétude qui s’empare de moi était une bonne nouvelle, enfin une nouvelle, avec son odeur de soufre et d’explosifs.
Je fume une cigarette, et puis je descends et rejoins l’aile de Catherine.
Avec ses baies vitrées éclatantes de propreté, ses meubles aux lignes douces, ses tapis partout, l’autre partie de la maison rutile et ne me rappelle rien. Depuis plusieurs années, Catherine anime des stages et des formations en « communication non violente ». Elle me salue sans s’étonner davantage que Céline, sans se demander non plus qui est cette femme en vieux jogging et T-shirt trop grand qui arrive sans prévenir. « Chaque fin d’après-midi, nous nous réunissons, les stagiaires et moi, pour échanger sur nos émotions du jour. Assieds-toi avec nous. »
Catherine parle de ses enfants et de son compagnon, et des deux chiens de la maison. Chacun·e écoute son récit enjoué. Celles et ceux dont elle parle ne sont pas là. La mélopée de Catherine monte et on entend bientôt autour des bruits inquiétants, des cris, des récits, des gémissements. Dans le couloir ou les escaliers de la maison, des choses apparaissent et disparaissent. Insectes, traces de sang, empreintes d’animaux. Et les murs se lézardent, puis reprennent leur état d’origine. Les murs parlent en étranges soliloques. Depuis l’intérieur, on voit les lumières s’allumer et s’éteindre dehors. Du côté de la piscine, des clapotis étranges et des sons gutturaux.
Catherine est imperturbable. Ou plutôt, elle semble de plus en plus rieuse et désireuse de les emmener dans son histoire de promenade en bateau. Elle éclate de rire, elle parle de plus en plus fort, elle attrape chaque convive par les yeux.
Le salon semble se rétrécir. Le malaise grandit. Catherine semble parfaitement maitresse des choses. Elle exulte même. Tou·tes se terrent dans les coussins et se concentrent sur cette histoire de croisière. Les paroles de Catherine ne laissent aucun répit.
30/03/2020 - Mat Carson
Bisaigüe – épisode 2
En fait je déteste cet endroit, je ne sais plus être assise avec des gens comme ça. Je me lève alors que Catherine harangue encore ses stagiaires médusés, je quitte la pièce, et tout le monde s’en fout. Ces mots vont me rendre folle, déjà je ne sais plus où se trouve la porte, je reconnais à peine le couloir. Ça résonne longuement : tellement longtemps que je n’avais pas entendu de vive voix ces mots-là. Bienveillance. Empathie. Récupération. Calme. Bien-être. Créativité. Je me sens mal.
Je traverse en courant l’aile de la maison. Je suis toujours pieds nus, jogging tombant, déformé par le paquet de clopes dans la poche, T-shirt mou qui glisse toujours sur l’épaule gauche. Le hall aux carreaux fêlés résonne doucement. Une femme monte les escaliers sans me voir. Ce n’est pas la même que tout à l’heure. Plus âgée peut-être. De lourds cheveux bouclés, blonds et gris, tombent dans son dos. Elle disparaît.
Si je reprends l’escalier qui descend vers la cave aux odeurs de fioul, je retrouverai la chambre blanche, mon confinement d’angoisse et d’ennui, le belvédère sur la ville morte, les sorties honteuses, le vide laissé par celles et ceux que j’ai perdu·es dans ces semaines sans fin. La porte grince, l’odeur est là, l’escalier s’enfonce vers le sous-sol. Mais en regardant en bas, je vois une petite fille. Brune, coupe au bol trop longue sur les yeux et les oreilles, longue tunique mauve. On dirait moi enfant, mais elle parle d’une voix monocorde et effrayante.
Je suis un enfant au pied de l’escalier. L’escalier est immense. Je le connais l’escalier en bois sombre où il fait toujours froid je reste en bas de l’escalier qui pue la cire et la poussière je suis bloquée en bas, la nuque cassée en arrière au-dessus, l’escalier, ses quatre volées de marches qui semblent bouger, se resserrer.
Je referme la porte à toute volée. Ce truc est insupportable. Bordel je veux descendre ! Reprendre son souffle et rouvrir la porte, plus fort, plus décidé, l’apparition merdique disparaîtra. Je m’engouffre en tapant fort les marches du talon. La maudite voix reprend. La gamine me ressemble pas tant que ça : elle gémit maintenant et son visage se tord.
Je suis là depuis très longtemps, je ne suis plus un enfant de l’escalier. Tombent des cris qui me giflent. Je reçois des coulées d’un liquide gluant l’escalier en est tapis et je ne pourrais jamais monter. Je veux crier « arrêtez » mais aucun son ne monte de ma gorge.
Faites-la taire ! Je remonte et trébuche, le genou contre une marche, et je gueule. Remonte pliée en deux pendant que la voix larmoie, me poursuit, étouffe de sanglots affreux.
L’escalier devient une chose vivante, les marches grouillent de mille-pattes et l’ouvrage se tord comme un estomac plein de sucs. Je sens mon corps se vider de toute volonté et s’enfoncer dans le carrelage jaune, bleu et rouge moucheté, devenu mou et tiède, exhalant une odeur vinaigrée qui me prend la gorge dans l’escalier, descendent des gens inconnus, avec une lenteur insoutenable, des corps désarticulés à qui il manque des morceaux, d’où semblent sortir comme des glouglous rauques pleins de bribes de voix que je connais. Je sens comme un poids sur ma nuque ployée en arrière et ça craque.
Je suis assise dos à la porte, à mordre mon poing, quand je sens une main me toucher doucement l’épaule.
Une petite femme brune aux cheveux très courts se tient devant moi, un genou au sol. Elle est habillée d’un bleu de travail devenu pervenche tellement il semble avoir servi. Aux coins de ses yeux s’étendent des rides en étoiles.
« Tu as crié fort. Je me reposais en haut mais tu m’as fait peur. Tu voulais descendre ? »
« Oui mais non. Mais y a quoi en bas ? », je hoquète bêtement.
« Moi c’est Saskia », me dit-elle en se relevant et en me hissant légèrement. Je suis debout et je la suis dans la cuisine. Du thé fume et je ne sais plus quoi dire. Je me retrouve assise face à cette femme qui semble avoir oublié la cave et mes hurlements. Pas plus que Céline plus tôt dans la journée elle ne semble vouloir savoir pourquoi je suis là. Bon.
On s’assoit donc ensemble pour boire du thé. Saskia sort une boîte de gâteaux d’un placard brinquebalant. Elle se met à me raconter son quotidien.
« Quelques mois après le confinement, mon boulot de standardiste dans une grande compagnie de transport n’avait plus aucun sens. J’enchainais les périodes de chômage partiel et les périodes où travailler me rendait malade, parce que ça consistait à envoyer sur les routes des gens qui n’allaient pas bien, soit parce qu’ils devaient alors délaisser les leurs, soit parce qu’ils n’étaient pas immunisés contre le virus et qu’ils craignaient de tomber malades. Et avec la faillite de la plupart des hôpitaux de l’État, ils avaient peur.
Et puis j’ai perdu mon appartement. Dans la rue, j’ai croisé Marie-Laure, que j’avais rencontrée ici quand nous étions adolescentes. Elle m’a dit que la Bisaigüe était vide et qu’elle était en train de s’y installer. »
Je n’en reviens pas : « Tu étais déjà venue ici ? Mais quand ? »
Saskia sourit : « Alors je ne sais pas de quoi j’ai l’air mais j’ai vécu ici de 1985 à 1989, j’avais entre 16 et 20 ans. »
Les yeux étoilés et le regard voilé de tristesse de Saskia auraient pu me mettre sur la voie. Mais j’étais loin de lui donner 50 ans. Son corps menu et tonique lui garde un air adolescent. Ses cheveux sont très bruns, une boucle lourde retombe sur son oreille, et l’autre côté est rasé, découvrant un tatouage derrière le pavillon légèrement ourlé. Sa peau est très brune.
Elle poursuit : « Je suis devenue aidante pour un centre venant en aide aux victimes de violences familiales. Depuis que les gens ne sortaient quasiment plus de chez eux, c’était le déchaînement dans plein de maisons. Et on a mis en place un réseau d’aide, petit à petit. Pendant plusieurs heures par jour, je reçois les appels, et le reste de la journée, parfois aussi un peu la nuit, on est plusieurs à organiser la mise à l’abri de celles et ceux qui veulent quitter l’endroit où ils habitaient. Il faut trouver des lieux vides, les aménager avec ce qu’on trouve, trouver des moyens de survie, suivre les premières semaines d’installation, parfois rester avec elles et eux, notamment quand il y a des enfants petits… Hé ça va ? »
« Oui. Enfin non ». Je comprends sans oser poser la question que nous ne sommes pas en 2021, mais peut-être bien plus tard. Quand je me suis couchée hier les hôpitaux fonctionnaient encore mal, mais on pouvait espérer se faire soigner. Les violences conjugales et les violences sur les enfants, on savait que c’était pas la fête, mais on peinait à mobiliser les faibles moyens qui existaient avant.
Et puis je ne comprends pas. Moi aussi je suis venue ici. De mes quatorze à mes seize ans, je suis venue là avec des ami·es. Leur père dirigeait ce centre. Je venais y faire de la photo et de la vidéo. Je n’y avais pas repensé depuis le confinement. Je me lève d’un bond, et ça tourne. Mes tempes vibrent et mon champ de vision se réduit. Je tombe.
Je me réveille allongée dans la salle de bain bleue. Saskia a calé mes jambes en l’air sur le rebord. De l’eau chaude coule et embue déjà tout.
« Moi aussi je suis venue ici » Saskia pose un doigt sur ma bouche. « Je sais. Tu vas te lever doucement et entrer dans l’eau. Je vais te tenir la main. Tu me raconteras si tu veux. Mais tu n’as pas à justifier ta présence ici. »
Mon corps répond tout doucement, les murs ne tournent plus autour de moi, mais les bras et les jambes qui semblent fichés dans les murs me font frissonner. Je glisse dans l’eau chaude.
Saskia fume, en tailleur sur le tapis, en me tenant la main. Elle tourne les boutons d’une radio hors d’âge. Et dans la pièce saturée d’eau résonne soudain Teenage Kicks, The Undertones. Et on rit. Are teenage dream’s so hard to beat ?
01/04/2020 - Mat Carson
épisode 2
par ici !
keep scrolling !
STOP !
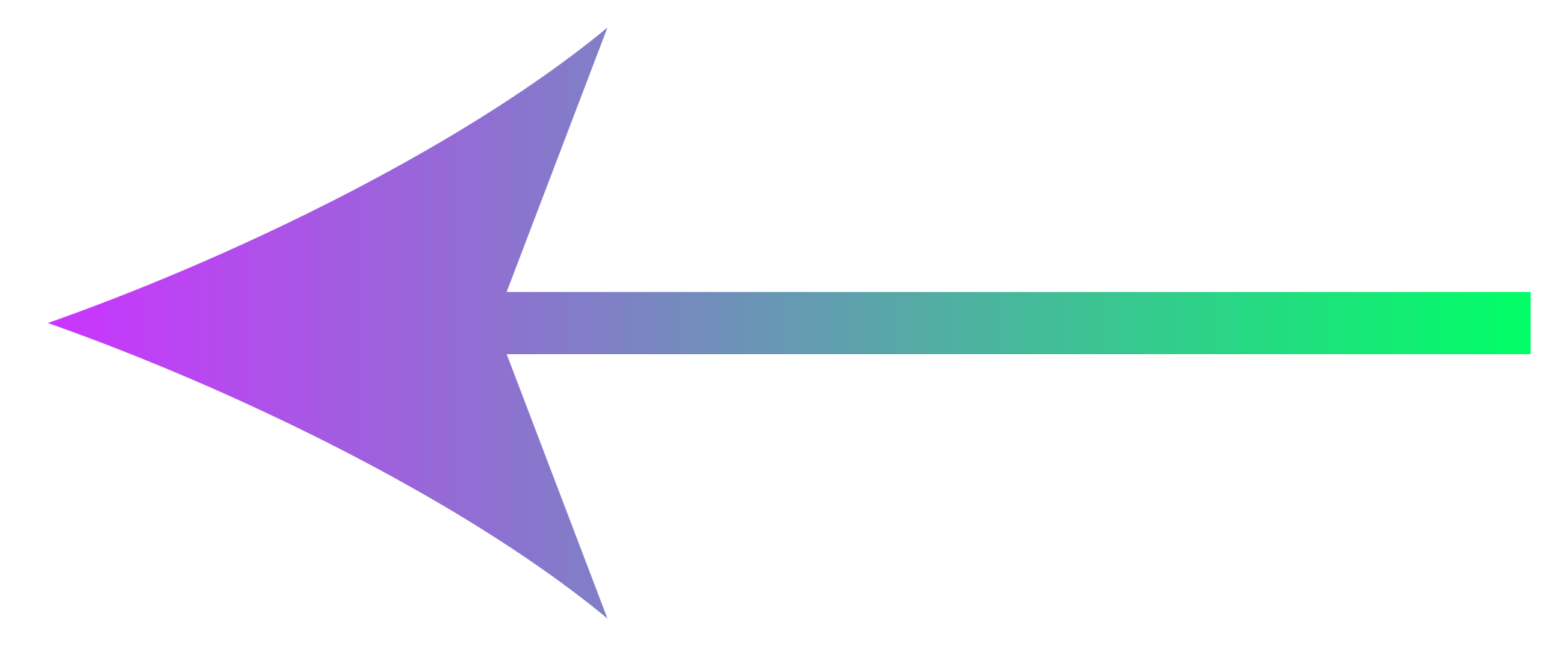
Bisaigüe – épisode 3
« Everytime she walks down the street
Another girl in the neighborhood
Wish she was mine, she looks so good »
La musique tourne un peu dans la pièce, résonnant entre les murs bleus, et l’eau clapote à peine. Rester allongée là, à regarder entre mes paupières paresseuses les volutes de Saskia, entendre son souffle calme, et se foutre de l’eau qui tiédit doucement.
« Je sais que tu es venue là il y a longtemps. Nous le savons, Marie-Laure, Céline et moi »
La voix de Saskia me secoue. Sa main tient la mienne.
« On s’est retrouvées ici avec Marie-Laure. On tournait un peu en rond. Elle aussi elle était déjà venue. Un jour on a commencé à regarder les vidéos sur les cassettes qui trainaient sur les étagères. Des heures de rushes jamais montées. Quelques petits films plus ou moins terminés. Avec de la musique ou avec les voix des acteurs. Les acteurs et les actrices qui jouent ou qui se parlent entre les prises. »
Je me crispe d’un coup dans la baignoire où je commençais à glisser. « Quels films ? C’était où ? »
Saskia me regarde en souriant doucement. « On a cherché un peu. Marie-Laure et moi ne les connaissions que vaguement, ces films, on n’était pas dessus. Les cassettes portaient des inscriptions à moitié effacées : « 1994, étang », « 1995, chapelle », d’autres indications comme celles-là. Vagues. Entre 1993 et 1995. Elle et moi n’étions plus là dans ces années.
On y voyait des visages qui nous rappelaient des trucs. Sans savoir trop. Des enfants, des adolescent·es. Plein. Et puis bien sûr, ses enfants à lui. Marie-Laure les connaissait mieux que moi. Moi je les avais croisé·es petit·es. Marie-Laure les voyait encore parfois.
Malgré la qualité pas toujours terrible, malgré les costumes et l’éclairage, on s’est mis à lister les visages qu’on reconnaissait et c’était pas facile parce que les mômes changeaient d’une vidéo à l’autre. Autre saison, cheveux plus longs ou plus courts, visages méconnaissables. Beaucoup de visages, mais on a fini par compter à peu près 25 personnes, entre 9-10 ans et 16-17 ans.
Parmi ces visages il y avait toi. Et puis Céline aussi. Quand Céline est arrivée ici au début du confinement, on la connaissait déjà et on n’a pas posé de questions. »
Tout d’un coup, j’ai envie de sortir de ce bain qui maintenant me glace.
Ces films je les connais. Enfin j’ai rarement vu les rushes. Mais je me souviens comme de rêves étranges de ces tournages. Une nuit dans un camion, mes rires avec Elle, des bougies et des capes, nos rires parce qu’à la fois on aimait ces histoires de nymphes un peu mystérieuses et ces récits foutraques, et on les détestait un peu aussi. On avait envie de s’en moquer, de débarquer avec nos blousons et nos chansons à nous au milieu des répliques poétiques et des lueurs de flammes. De craquer et de cracher nos pipas au milieu des scènes, emmaillotées dans des capes blanches et des couronnes de fleurs dans nos cheveux noirs emmêlés.
« Saskia, je voudrais dormir »
Je me lève et me sèche dans le drap que me tend Saskia. Et renfile mes vêtements fatigués, encore un peu humides. Elle m’accompagne dans le long couloir.
« Oui je suis venue là. Oui j’étais sur les films.
On faisait du théâtre aussi
Un matin, je me suis réveillée,
malade,
dans un sac de couchage qui n’était pas le mien.
Le sac à la glissière ouverte jusqu’en bas,
le T-Shirt relevé sur mes seins,
la culotte baissée. »
Je marche dans ce couloir aveugle. Toutes les portes sont fermées, la pénombre est poussiéreuse et je vois les cheveux bruns de Saskia et sa silhouette bleue s’éclairer faiblement de rais de lumière quand on dépasse des chambres.
Je suffoque sans bruit. Il suffit de marcher derrière elle et je vais trouver un lit.
Je me rappellerai juste que je suis tombée sur le lit. Que Saskia est restée là. Que j’ai dit encore « J’avais seize ans ».
***********
Il faut trouver un endroit sec et fermé
Ranger ce sac de viande gluante
Entrer dans ce sous-sol
Espérer qu’il n’y a personne
Il faut entendre le bruit des pas pressés
Patauger dans cette boue putride, gluante
Traverser les galeries
Distinguer un bourdonnement qui monte
Il faut se débarrasser de ce poids
Les anses entaillent les mains de Saskia
Heurter les murs aux suintements
Cracher l’humidité qui dégouline, gluante
Il faut ressortir de là parce qu’elle pleure
Saskia tellement fine et forte
Geint et se traine, gluante
Et réclame un baiser quand je hurle
Il faut oublier l’odeur immonde
Et le vide dans ses yeux quand elle voit ses doigts
Ses mains pleines de sang qu’elle ne comprend pas
Sa colère toute vide et gluante
Il faut sortir de là, la viande coule
Le bout du tunnel
Le torrent de guêpes sur nos corps souillés
On n’y arrivera pas
**********
Réveillée en sueur. Combien de temps plus tard ? La maison bouge un peu même si ça ressemble à l’aube. Le ciel est encore bleu dur et l’horizon se colore d’un feu sale. De la fenêtre aux rideaux déchirés je vois le jardin. La piscine couverte de feuilles. Le pull rouge a disparu.
Des bruits de voix dans les couloirs, des portes qui grincent et claquent.
Je sors de ma chambre et je descends l’escalier. Plusieurs personnes s’engouffrent dans l’espèce de corridor qui mène à l’aile de Catherine. Sans me voir, sans m’entendre.
Dans la cuisine, la femme très grande que j’avais aperçue dans l’escalier. Ce doit être Marie-Laure. Elle chante doucement et lève la tête quand j’entre. Me sourit.
« Toi c’est Amélia ! »
Je me souviens d’elle. Elle se souvient de moi. Et ça n’a pas grand sens là. La cuisine est plus délabrée que ce que j’avais remarqué la veille. Mais il y fait chaud et ça sent le ragoût et le cumin, et puis une odeur de pain. Marie-Laure chante une chanson de Leprest que j’entendais quand j’étais gosse. « Bilou Bilou, le feu follet la plus courue d'mes boums, Le bonheur sur ta peau a retourné sa veste. »
Elle tourne le bouton d’un vieux poste de radio aux gros boutons poussoirs poussiéreux. Un journaliste dont on a oublié le nom pose des questions absurdes à un chercheur en économie. Nous parlons un peu. Marie-Laure va sortir un peu, elle me demande si je veux venir. Puis nous nous taisons en entendant le jingle crispant des annonces gouvernementales.
« Nous interrompons notre programme pour vous signaler une information de la plus haute importance :
Une partie des eaux terrestres a été empoisonnée la nuit dernière. Des ruisseaux aux fleuves, des nappes aux citernes, une partie de l’eau est impropre à la consommation. Nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution de filtrage adaptée.
Nous enjoignons la population à rester calme. Ne prenez pas de douches ou de bains. Ne vous ruez pas dans les supermarchés, les stocks d’eau en bouteille sont déjà épuisés et nous attendons le chiffre de l’indice boursier de Nestlé. Une enquête sera menée pour comprendre comment l’information de la pénurie a fuité.
L’eau des piscines est également toxique. L’eau de mer devrait être peu impactée. Les châteaux d’eau sont pris d’assaut. Restez chez vous, buvez lentement tous les liquides embouteillés que vous détenez.
Ne paniquez pas. »
Les voix du journaliste et de son interlocuteur reviennent, entrecoupées de silences. « Dans cette crise, qui touche à la fois l’offre et la demande, chaque pays tente d’apporter une réponse en fonction de ses moyens » tente de reprendre le chercheur. Un long ricanement s’ensuit. Les voix des deux types se mêlent et ne sont plus qu’un plaintif et saccadé rire, inquiétant, rauque, et bientôt noyé dans un morceau de musique baroque, strident aussi. Marie-Laure éteint la radio d’un geste brusque, soupire, me regarde. « On y va ? » me dit-elle dans un sourire.
12/04/2020 - Mat Carson
EPISODE 3 !